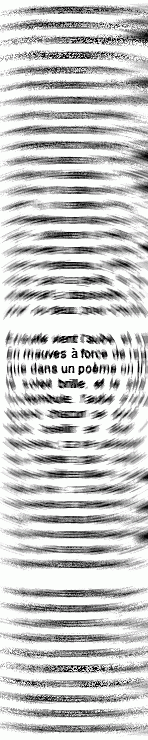lundi, 14 mars 2011
Dans l'épaisseur des images, on ne sait où. (part 1)
Si l'on ne trouve pas surnaturel l'ordinaire, à quoi bon poursuivre ?

Ici, je traine encore des heures à l'entresol pas loin, dans une cafeteria qui ressemble encore à une salle de bain, conçue pour tous, d'un goût moyen, au décor sans aspérité. Des familles, des collègues de bureau, ou des couples, du genre illégitimes s'y retrouvent et déjeunent ensemble. "Ensemble" est un mot impossible. Juste un éclat. Je poursuis mon vol à l'étal dans cet espace climatisé qui m'offre toutes sortes de livres, dont certains à jamais prisonniers du silo. "Les oiseaux" pas très loin des "Métamorphoses", au rayon étranger, près d'Ovide en exil, je suis enfin chez moi. Je pille et je repille les modernes, les classiques. L'image inspire autant les sons, les couleurs apocalyptiques des bruits de Russolo, et les troupeaux Dada qui vont jouer pas loin du rayon "bonne cuisine", les revers d'un naufrage passé à la postérité :
Buvez du lait d'oiseaux
Lavez vos chocolats
Mangez du veau
Cette chose finira bien par nous anéantir, comme Dada, au nez des artistes, n'avait cessé de l'espérer. Ailleurs, parodiant le décompte des passions impossibles, une trame lourde tient ces mondes à la botte de la correction. L'amour et le désert qui l'accompagne, les secrets bafoués et les exhibitions ; cette normalisation qui suit l'extase, c'est cela le désastre. Il n'effleure pas l'esprit des naufragés déclinés au carré, anguleux comme des tombes, où la poésie ne crache plus. Un minimum vital de poison, survit un peu, détaché des abus, une sève diluée dans une solution tiéde, étouffée de soupirs aux semblants soulagés comme nous pleurons l'absence, bercés sur des jonques colorées de flonflons qui plaisent à peu près à tout le monde. Ensuite vient aux index, un ajoût sérieux de notes appliquées, des numérotations interminables. L'abondance suffirait-elle à conjurer un manque qui en cache d'autres ?
Nous sommes nombreux, penchés religieusement sur les pages, dans les allées sournoises de ces caissons d'isolation. On entend un bruissement, un son rassurant d'effeuillage. Que cherchons nous ? Le processus s'enclenche, le domaine écope l'eau ; jaune et noir comme le Rhône qui draîne ses corps sous des bateaux où chaque soir on danse dans les reflets des ponts jusqu'au lever du jour. Chacun chorégraphié en dépit des mouvements de son être, happé par l'obsession d'une partie qui expliquerait le tout. Ce qu'il reste à savoir est un grand poème fleuve, assiégé de vers fous voués à l'irrévérence. On plongerait dans ce flux, la saleté des remous, un déferlement de phrases qui ne diront jamais assez tout le mal d'être au monde, l'oubli, et les reflux, le déni, le re-flou. Là, des couleurs sépias au souvenir du Valois :
Il parlait de celles de ce temps-là sans doute ! mais il m'avait raconté tant d'histoires de ses illusions, de ses déceptions, et montré tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu'il utilisait depuis à parer des tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m'en faisant l'histoire et le compte définitif, que je m'étais habitué à penser mal de toutes sans tenir compte de l'ordre des temps.
Ici la paysanne et la vierge "Aurélia" :
Puis les monstres changeaient de forme, dépouillant leurs premières peaux, se dressaient puissants sur des pattes gigantesques ; l'énorme de leurs corps brisait les branches et les herbages, dans le désordre de la nature, ils se livraient combats auxquels je prenais part moi-même, j'avais un corps aussi étrange que les leurs. Tout à coup une singulière harmonie résonna dans nos solitudes, et il semblait que les cris, les rugissements, les sifflements confus des êtres primitifs se modulassent désormais sur cet air divin. Les variations se succédaient à l'infini, la planète s'éclairait peu à peu, formes divines se dessinaient sur la verdure et sur les profondeurs des bocages, et, désormais domptés, les monstres que j'avais vus dépouillaient leurs formes bizarres et devenaient hommes et femmes ; d'autres revêtaient, dans leurs transformations, la figure des bêtes sauvages, des poissons et des oiseaux.
Ailleurs, des figures doubles dépourvues d'ombre, des femmes assoupies, des muses grimées en vouivre, traverseraient nos villes sur un nuages de cendre. Il se peut qu'on rêvasse et la nuit en pillant les archives glissées entre les pierres des monuments, il se peut que reviennent des pans de vies anciennes miraculeusement préservées, hâtant la joie sereine des affinités mystérieuses qui exigent l'anéantissement, peut-être... On se jetterait à distance vous et moi, d'un balcon à un autre en saluant les princes qui passent lentement dans des fiacres sous de vieux luminaires, vous et moi aspirant à cueillir quelques bourgeons de roses, dans la beauté du leurre, à confondre, les locataires qui vivent là où jadis habitaient les Dieux, avec les Dieux eux mêmes. On nouerait au passage, le souvenir d'un songe à des formes plus lointaines. Les monstres des bestiaires monteraient jusqu'à nos fronts y coller l'escarboucle, un troisième oeil étincelant légué par des visionnaires revenus déposer le ciel à nos pieds. La lumière se fait rare, nous resterons au piège d'un débit de conversation qui n'est plus à nous mêmes et qui revient sans cesse, déformé par l'image animant un rocher, sorti du ventre de la terre : une carcasse d'archéoptéryx qu'on n'aura même pas le droit de caresser.
"Je marchais péniblement à travers les ronces, comme pour saisir l’ombre agrandie qui m’échappait : mais je me heurtai à un pan de mur dégradé, au pied duquel gisait un buste de femme. En le relevant, j’eus la persuasion que c’était le sien... Je reconnus des traits chéris, et, portant les yeux autour de moi, je vis que le jardin avait pris l’aspect d’un cimetière. Des voix disaient : “L’Univers est dans la nuit !"
CLAUDE LE JEUNE : "Que je porte d'envie" (pour 4 voix, 4 violes)
Lien : "dans l'épaisseur des images on ne sait où" (2) Lire ICI
Photo : Géante rouge traversant la Tupin en aveugle, dans l'apparente tranquillité d'un jour de Mars.
© Frb 2010.
vendredi, 04 mars 2011
Le tour du bois
Le bon bois ne pousse pas dans la facilité (eh non !)
PROVERBE CHINOIS (traduction Félicie Dubois)
Même à l'envers, "pourtant il marche" (cf. lecture pour tous) cliquez-y dessus pour voir...
Bois capétien "bosc" ou buisson broglios, bois humide, tour de haie, clos du Marquis, toponyme, Breuil le vert, Breuil bois Robert, portail du bois, "sève brute, grosse tige", bois de bout, jeunes pousses, moelle spongieuse, duramen bois parfait, cernes anciennes, écorce et cambium libéro-ligneux, sève élaborée du liber, protection du suber et de la subérine, méristème secondaire entre liber et suber, cambium subero phellodermique grand producteur de phelloderme et de suber, bois de printemps, vaisseaux, tendre vaisseaux riches, bois d'été, dense, résistant, essences du bois, hétérogène comme "chêne", bois homogène comme "hêtre", cernes résultant de l'alternance des saisons, résineux gymnospermes, bois hétéroxylés, feuillus angiospermes, parenchymes, vaisseaux et leurs motifs particuliers, rayons ligneux ou médulaires à parois épaissies lignifiées, orientation transversale rayonnante, maillure caractéristique du "niangon", carbone, oxygène, hydrogène, azote, cendre, eau libre, bois vert, eau liée composant les fibres, bois flottant par les vides composant sa structure, bois qui dure: cèdre, robinier, châtaignier, chêne, bois qui dure pas : hêtre, peuplier, tilleul, épicéa. Champignons entrant dans sa blessure, résineux bleuissants exposés aux intempéries, lignivores, pourriture cubique, fibreuse, pourriture molle, ennemi qui vient : mérule pleureuse, tache duvetée blanche sur sols humides, xylophages attaquant les grumes, larves qui creusent des galeries dans les bois, géométrie des vermoulures, capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, invasion des termites, défauts du bois : roulure, gélivure, cadranure, coloration du coeur, noir pour frêne, rouge pour chêne, fil ondulé et torse à l'entre-écorce, bois madré ou ronceux, broussins, loupes, poteaux, rondelles, sciages, refente, charbon de bois et pellet, granulé de bois, bois d'oeuvre scié dans les grumes, bois empilé, maisons, charpentes, bois rabotés, bordés, pièces de quille, échafaudages, palettes, lambris, parquets, tranches plus fines, emballages, lamelles ou cabane en rondins, trituration, laine de bois, particules, contreplaqués, merrains ou bardeaux de toitures, bois cintrés, tabouret, manches à outils, pâte à papiers, marqueterie, sculpture, peinture à tempera, huiles essentielles gommes, résines, latex, pousses de bambou, ocarina, pipeau, flûte, "le souffle d'air s'y fend", anche simple vibrant, anche double sur le vieux principe du ballon, tuyaux cylindriques: flûte de pan (plus le tube est court plus la note est aigue), hautbois de perce cônique, bombarde en ébène, chalémies (de la renaissance), duduk (d'Arménie ou du nord), cornemuse à bourdons (de Galice), hichiriki, zurnas, zamr et karamouzas, surnajs, le biniou cause, veules veuzes tonalité du do en buis, cromornes au bois des écuries, fibres de buis, poirier, bois de rose, cocobolo bois de grenadille, poudre d'ébène au bois philarmonique, au bois d'amour, au bois baryton, dendrométrie, cubage et carton de la chute : "dragon molto orribile e spaventoso", peint sur bois de figuier, char en bois, bouclier, Première fringue du figuier, fruit du bois, bois de ta peine, prions pourSaint Amand, drus l'abattant sous le règne de John D. copeaux, allumettes, cure-dents, rognures...
BOWERBIRDS: "Beneath Your Tree"
Photo : Le tour du bois (vite fait) derrière chez moi, (ou devant chez vous) assise (hors champ) sur la dernière branche de l'hiver au clos bôteret pas très loin du château du Marquis. Dernière balade alcestienne avant de solder l'hiver, et de s'en retourner clopin-clopant à l'éternel printemps, (quelle horreur !).
© Frb 2011.
06:40 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Le vieux Monde, Mémoire collective, Objets sonores | Lien permanent
mardi, 01 mars 2011
Le dernier mouvement de l'hiver
Toute connaissance de l'intimité des choses est immédiatement un poème.
GASTON BACHELARD : "La terre et les rêveries du repos", éditions José Corti - "Les massicotés", 1948.
DIE SCHWINDLINGE: "What A B what a beauty"
Photos : On parle toujours des feuilles d'automne, jamais des feuilles d'hiver. Nous rendons justice aujourd'hui. Le dernier mouvement de l'hiver, ouvre un Mars retardataire avant le premier mouvement du printemps, à suivre... Photographies from Nabirosina. © Frb 2011.
03:31 Publié dans Actualité, Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, De visu, Impromptus, Mémoire collective, Objets sonores | Lien permanent
samedi, 26 février 2011
Entre les lignes, (remix by Hozan Kebo)
Entre les lignes, si on les fait trembler...
D'un texte écrit entre les lignes, (voir ICI), perplexité, on ne peut rien en dire, ni rien en expliquer. Hozan Kebo comprend alors qu'il faudra peut-être faire trembler quelque chose (les lignes, par exemple !) pour toucher le coeur du sujet mais pour l'heure, on n'en dévoilera pas la fin.
Scotty Mc Kay Quintet: "Train kept a' rollin"
Illustration : Hozan Kebo Fevrier 2011.
08:56 Publié dans Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, Correspondances, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Tapis rouge !, Transports | Lien permanent
jeudi, 24 février 2011
Entre les lignes
Accommodé avec un regard et un sourire appropriés, le silence peut donner d'excellents résultats.
JEAN ECHENOZ, extr. "Je m'en vais" éditions de Minuit, 1999
 Un système désastreux s'installe. On souhaiterait le cacher dans les interférences pour ajouter aux sensations élaguer la parole. Hier encore, il semblait simple de marcher en silence, la pureté de l'air, nous allégeait, un peu. Nous avions découvert une parfaite nébuleuse par réflexion, comme l'étoile Antarés possède un compagnon. Une paire d'étoiles en orbite mutuelle tournant chacune autour de l'autre, formant un double optique, alignées par hasard, nous retournions à ce hasard, qui par défaut, neutralisait. Un jour, on ouvrirait les yeux aux semblants d'échos machinés dans les vernis de l'emballage qui reviennent d'un vague à l'âme vieux comme le monde et se perdent en toutes saisons. On voulait ne faire qu'un avec le plus grand nombre, on désirait l'élévation, mais c'est encore la mort qui rôde dans les maisons, blesse les animaux et humilie leurs maîtres quand la nuit vient, ils perdent leur charme soumis aux travaux ménagers, ils remettent en place les objets pour le lendemain, ils se heurtent à huis clos, cultivent le métal contre l'or lentement fondu et gâché, le métal tourmente, prend forme humaine, ils vont la nuit, les bras chargés de sacs mystérieux, griffés par une bruine qui ferait fondre les paysages mais pas la geôle, le bruit du tonnerre au milieu de l'hiver plus tard, inviterait à disparaître et l'on disparaîtrait dans l'espoir de renaître, un jour, ou deux, pour d'autres.
Un système désastreux s'installe. On souhaiterait le cacher dans les interférences pour ajouter aux sensations élaguer la parole. Hier encore, il semblait simple de marcher en silence, la pureté de l'air, nous allégeait, un peu. Nous avions découvert une parfaite nébuleuse par réflexion, comme l'étoile Antarés possède un compagnon. Une paire d'étoiles en orbite mutuelle tournant chacune autour de l'autre, formant un double optique, alignées par hasard, nous retournions à ce hasard, qui par défaut, neutralisait. Un jour, on ouvrirait les yeux aux semblants d'échos machinés dans les vernis de l'emballage qui reviennent d'un vague à l'âme vieux comme le monde et se perdent en toutes saisons. On voulait ne faire qu'un avec le plus grand nombre, on désirait l'élévation, mais c'est encore la mort qui rôde dans les maisons, blesse les animaux et humilie leurs maîtres quand la nuit vient, ils perdent leur charme soumis aux travaux ménagers, ils remettent en place les objets pour le lendemain, ils se heurtent à huis clos, cultivent le métal contre l'or lentement fondu et gâché, le métal tourmente, prend forme humaine, ils vont la nuit, les bras chargés de sacs mystérieux, griffés par une bruine qui ferait fondre les paysages mais pas la geôle, le bruit du tonnerre au milieu de l'hiver plus tard, inviterait à disparaître et l'on disparaîtrait dans l'espoir de renaître, un jour, ou deux, pour d'autres.
Ensuite vient l'aube, et ses teintes douceâtres, qu'on avait cru si vives ou mauves à force de regarder des images à l'aérographe et de croire que dans un poème on trouverait le nouveau monde. Mais rien ne tient, le soleil brille, et le silence jamais ne décape les geôles. Pour le noctambule, l'aube s'ouvre encore sur la nuit noire. Aux terrasses quand chacun se dore, des pages entières s'effacent, plus rien ne vient cueillir en rêve l'allégement, l'escalade aux sommets. On descend, ça ne prévient pas. Pour parer, on invente des enluminure aux pastels gras contre l'encre sèche, sèchant sur le sujet curieux d'une quête située à peu près nulle part avec presque personne, on dirait pire : ça décrète sans penser, ça pisse froid sous la douche écossaise ça reprend tout ce qui était donné, et le reste fantômatique, qu'il n'aurait pas fallu toucher. On ne devrait pas laisser le hasard à ce point nous déposséder. Il reste encore le vent, ni chaud ni froid et tout le luxe des vagues de la mer qui pénètrent dans des buvards où dorment d'hallucinants corsaires hantés par le chant des baleines.
Il reste des lettres pliées en petits morceaux, jetées, au loin dans des bouteilles reculant les limites. On s'éloigne, tout s'échoue à la claque sur des grèves. C'est chaque jour le retour à zéro, ce temps de grand bien être à n'être rien ou ne plus être dans ce monde qu'un guetteur en vacance. Comme il est doux ! ce rien. Il ne resterait plus qu'à retrouver la trace originale du premier homme qui fît le tour de la terre en Alpha Roméo, et ne claquer sa poésie qu'avec les hippies chics dans les fêtes légères, à rire avec les mouette aux jardins d'une villa en bord de Saône, décorée à l'antique pareille à la Villa Romaine, où nous vîmes autrefois, au milieu d'un salon mi jardin mi partouze, l'après-midi bleu pâle virer en soirées pourpres, où venaient les stridences du violon de Tuxedomoon, à en oublier les hommes ordinaires qui ploient sous le conditionnel, parmi des tableaux de conjugaisons livrent des verbes inconjugables à des otages privés d'amour, l'alphabet en lambeaux, ils voulaient le prendre à bras le corps, dans le but d'en relier les courbes pour fabriquer un mot exprès imprononçable. Tout cela resterait brouillé dans le traducteur des gougles charriant le staccato aussi vain que les nébuleuses enfermées dans une cage à poule.
On déplacera les personnages, de la réalité à la fiction puis on sommera le tout d'attirer l'oeil, l'intelligence, les appareils-photo, on ajoutera le son, peut-être des micros. Pendant ce temps nous mangerons des glaces sur le quai St Antoine, cédant à toutes les tentations, nous remonterons le temps, par la grande rue qui mène à la grande gare. Ou bien plus loin la nuit, nous irons chercher sur les pentes, un banc de square, je mettrai une radio portative sur mes genoux, la molette coincée entre le pouce et l'index, nous tournerons jusqu'à Varsovie et Moscou, au code secret d'un vieux message, qui balayerait la terre entière par d'autres voix inoffensives, des faisceaux lumineux éblouissant les ombres à la manière d'un phare, qui s'étendrait des heures au dessus de la ville. Ce halo avale la nuit noire où les noctambules s'illuminent, et tous les mensonges leur reviennnent à la première clarté du jour mais entretemps, nous aurons changé de ville...
Il faudrait tout quitter comme on s'envoûte progressivement du va-et vient des vagues, puis revenir et repartir, mourir un peu, revivre etc ... A se sentir porté par un mouvement passant de chaud à froid puis de froid à glacé, d'une glace qui brûle la vérité au milieu du système, dans une histoire écrite par d'autres, ils n'en veulent rien céder, et sans impunité nous déplacent sans cesse, dans ce continuum sur les parallèles compliquées, sans jamais nous solliciter. Un jour, la trame, heurterait de plein fouet quelque chose en dedans qui devrait imploser sans prévenir ou bien on laisserait tout aller avec ce qui renonce, une bribe de chanson annulée par l'épais brouillage des ondes courtes, masquerait pareil au secret, le premier, ou le dernier mot du langage oublié, précédant le silence qu'un long train à l'arrêt ne pourrait interrompre.
Photo : Aiguillages entre ciel et terre et des pilônes tagués de signaux sans mystère mais encore incompréhensibles. Vus d'un train à l'arrêt quelque part dans un no man's land, entre Lyon et Orléans. © Frb 2011.
14:12 Publié dans Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, De visu, Impromptus, Le nouveau Monde, Mémoire collective, Objets sonores, Transports | Lien permanent
dimanche, 20 février 2011
Ready (re)made : le Porte-foulard by Hozan Kebo
lundi, 14 février 2011
Ready (re)made for Valentine : le Porte-foulard
de hasard
il n'y a
"The Creative Act" by M.Duchamp
La citation est de Paul Eluard.
Le porte foulard ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Le porte-foulard se porte aussi sans foulard. (Voir ici).
Sans porte, et sans foulard, on irait vers où ?
Ready remade's nota : Pour la Saint Valentin, chers Valentins, offrez un Porte-foulard à l'élue de votre coeur Pratique, pas cher, gage d'une tendresse infinie, le Porte-foulard est à la fois une preuve d'amour originale et un meuble épatant. Plus fiable qu'un bracelet, moins superflu qu'un pendentif, offrir un porte-foulard est vraiment l'occasion rêvée de vous rendre à jamais inoubliable. Osez ! payez vous d'audace ! puisque l'amour ne saurait exister sans preuves, qu'attendez vous ? La rue Camille Jordan vous le donne et certains jours vous le vend (à bon prix)(*). Plus une seconde à perdre ! vous pouvez envoyer vos dons (sans bouger de votre fauteuil), dès aujourd'hui à: "Certains jours, "spécial St Valentin (retardataires 2011 et Valentins d'avant-garde 2012") au 1 rue Centrale 69, Lyon-cedex, ou téléphoner au Babylone 36-36 (demandez Marcel à l'accueil). En tapant sur la touche étoile, de votre taxiphone peut être serez vous parmi les heureux lauréats de notre grand tirage au sort qui vous permettra de gagner un Porte-torchons à deux battants. Profitez ! le jour des amoureux, c'est aussi le moment d'équiper la maison ! La St Valentin se fête certains jours mais elle se prépare chaque jour de la vie, (on n'est jamais trop prudent(e). © Frb 2011.
(*) Sous réserve des stocks disponibles, 499, 92 euros pièce le porte-foulard (foulard non fourni, 78,84 euros pièce, supplément porte-foulard mélaminé 345,87 euros le mètre, transport des foulards 800, 59 euros seulement, (avec option 156 euros/ heure, le ponçage ) renseignement frais de livraison tapez 36-15 porte-foulard cet appel vous sera facturé 7,89 euros/mn. Possibilité de crédit à 4,%à payable en 10 fois, sur présentation d'une fiche de paye. Le porte foulard existe en plusieurs coloris .Carte sénior acceptée.
samedi, 12 février 2011
Presqu'île (flottante)
Quant à moi ma résolution est prise, je vais aller quelques temps à Tahiti, une petite île d'Océanie où la vie matérielle peut se passer de l'argent. Je veux oublier tout le mauvais du passé et mourir là bas, ignoré d'ici, libre de peindre sans gloire aucune pour les autres.
PAUL GAUGUIN, extr. "Oviri, écrits d'un sauvage" (texte choisis et présentés par Daniel Guérin), éditions Gallimard, 1989
Tous les oiseaux exotiques de Lyon presqu'île se trouveront bien en chatouillant l'image.
Un tête à tête de vieux marins et de joyeux lurons aux tables des buvettes longeant les quais comme une histoire ancienne qui se répète. à l'infini. Des rues peuplées de femmes ordinaires et d'autres plus mystérieuses, rondes ou minces commes des statuettes elles se promènent pour le shopping, grandes têtes sur des tiges, plâtres sculptés aux hanches marquées, minces ou rondes, belles Botérisées en robes printanières grandes bringues classieuses accompagnées ou non, blotties dans des manteaux épais, étudiantes genre british en blazer à boutons dorés qu'on croirait fraîchement revenues de Londres, paupières peintes, couleurs vives, oeil avec ou sans chien, bras qui balancent le long des corps, avant, arrière les sacs de nos marques préférées. Inanité de la rue de la Ré, Lyon presqu'île sort de son labeur, c'est le moment des pauses, un trop plein de vie, un très grand petit monde s'éparpille sans cacher ses fringales, en heure de flemme, chacun s'ouvre au plaisir du museau vinaigrette, des mâchons au Garet ou ailleurs... Les tabliers de sapeur, l'andouillette à Bobosse connu pour sa gueule de tonton flingueur avec, dit-on, "une andouillette à la place du flingue", sabodet et groins d'âne ou bavette crépitant aux fenêtres basses des cuisines, odeurs de viandes grillées dans les impasses tièdes, les exotismes jouent la concurrence la quenelle quotidienne à force, aura lassé son monde, doublée par les lampions rouges kitsch qui roulent des nems dans les feuilles de menthe fraîche, et la faune hype and chic s'entichera des sushis-shop et des sushis-makis.
Il est midi, à Lyon Presqu'île. L'heure de grâce qui nous flaire et nous flâne, nous affiche complets aux terrasses ou dans les bouchons surchauffés avec les tables bien mises, les nappes en tissu à carreaux épais rouges et blancs, (sinon où serait le charme ?) la bonne franquette servie avec la bonhommie, et ce petit côte du Rhône surnommé (à juste titre), "boit sans soif", assuré à prix modéré sous les lampes rondes, rétros, lunaires de la Manille, notre bistro préféré, en presqu'île sur la Tupin, exactement. Tupin encore, on lit avec une pointe de nostalgie l'avis de fermeture définitive de la pharmacie je ne sais quoi qui fusionne avec la pharmacie je ne sais qui, et déménagera bientôt on ne sait où, (on sait, mais je ne m'en souviens pas), on regrettera parce qu'elle avait des beaux rayons de bois ouvragés à l'ancienne, décorés de bocaux anciens en céramique comme ceux de l'apothicaire, le vrai pas le vrai faux ancien, et on se demande qu'est ce qu'ils vont devenir ces beaux rayons en bois et ces bocaux à plantes. A la Tupin, encore quartier chaud autrefois, on regardera les cartes postales-fantaisie, les beaux stylos qui brillent à la vitrine d'une papeterie. On tournera par les rues, jadis infréquentables, queue de paons, queue de pies s'impatientent à la boulangerie de la Ferrandière pour y trouver les pains anciens cuits au vrai bois avec du vrai feu, dans un vrai four à bois. Le citadin aime le vrai, qu'on lui en montre, même si c'est du faux vrai, du presque vrai avec de la fausse preuve peu importe ! (Ferrandière c'est du vrai, je crois) tout tapera l'oeil si possible, mais les pains de la Ferrandière ne seront ni meilleurs ni plus authentiques que chez le boulanger Rodrigue, notre chouchou à nous moins tape à l'oeil et plus charmant pas loin de la rue de Brest, (qui n'est pas la rue Lebouteux, mais presque) là où la boulangère d'une prévenance d'un autre temps, est peut être la plus belle actrice, du dernier film que Rohmer ne tournera jamais. Chez Don Rodrigue tout va si gentiment que l'on sait (en causant d'un peu tout, trois fois rien), pourquoi la vie vaut quand même d'être vécue au delà des plus noitres (ou noirtes) trous noirs, ou gris désarrois.
J'irai là bas de l'autre côté du pont, à St Jean puis St Georges y chercher l'Italie, les vieux pavés en pierre et aux pralines (le pavé aux pralines étant au gourmand ce que le Galibier est au coureur cycliste, pour l'attaquer il faut être sûr de sa mâchoire, avoir des crocs pas des dents, enfin bref) et les glaces rhum-raisin, mais pas tout de suite... lci à Lyon presqu'île à midi il est bon de traîner et je traîne, longeant la Saône avec vue sur la rive florentine une rive droite et bancale qui descend jusqu'à Vaise avec ses façades pâles, multicolores, mouillées dans les reflets plus avenants que les reflets du Rhône. La Saône comme un ravin entre les parkings de rive droite décompose par temps clair la cathédrale St Jean (mi roman, mi gothique) qui s'y noit, troublée d'un vol de mouettes et en dessus dessous, (on ne sait plus trop), il y aura la Sainte Vierge qui domine la colline, prie pour nous avec des grenouilles cachéees dans des couvents et si on tend l'oreille, on devinera, là haut, à quelques mètres, la colline qui apprend la musique, pas loin des ruines gallo-romaines vers St Just, loin comme à la campagne. Juste autour de midi, la Saône comme un ravin est une parenthèse qui s'enchante de miettes, de mouettes, une valse de mondes flottants un peu entre les hommes et puis toute cette eau qui instille une espèce de joie démodée décalant l'hyper-nerf d'une ville. On se laisse attraper comme toujours. C'est l'heure de l'oubli des horaires, un temps de l'entre deux qui revient chaque jour, si patent, à la fin de l'hiver et la demi-saison nourrit les collections d'oiseaux, quand les mots tournent à vide chacun assis sur son muret, peut manger le froissement de l'aile d'un étourneau vivant presque dans sa main. Il y a l'air du printemps qui convie déjà le "langage des fleurs", les premiers mimosas (?) longeant les bancs des fleuristes du marché St Antoine, (pas loin de la buvette du même nom) les mimosas ne sont pas de Lyon mais ils inspirent des chants forains, tout à l'impro. D'autres bancs affichent le fromage vert étrange revenu d'une époque où la terre était bleue, on n'en doute pas, comme une orange. Un petite pause en passant du côté chez Paul pas les quatre Paul du choeur aimé de certains jours (faites entrer l'aimé quatuor : Verlaine, Valéry, Cézanne, et Gauguin), non, l'autre Paul, le collègue au Dédé, vous savez bien...)
La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s’entendre
Les fous et les amours ... (*)
Foin de la parenthèse des pouèmes, le temps d'une dégustation de fromage vert : "yes it is cheese, and yes it is green ! But it is not bad. It's better than nothing". J'ai appris en causant avec le forain ardéchois, (bien sympathique), que c'était du fromage hollandais au pesto, (fabriqué en Ardèche !), il volera la vedette (pas le forain, le fromage vert, (quoique le forain, ô ma faiblesse ! ayant les yeux aussi verts que son fromage on ne rechignera pas à poursuivre la dégustation, quitte à braver l'odieuse et rustre cancaillotte, enfin bref...) aux rangées sages de bleus (rangés comme des oranges) et des Mimolettes oranges (sans orange comme le bleu).
A midi, c'est l'heure des silences où revient la belle vie, quelque chose qui ressemble vaguement à la vacance, (en Italie, de préférence), un petit bateau gronde, il n'ira pas plus loin que l'île Barbe."Insula Barbara, Prévert ne l'aura pas connue, (ni volée, ah mais tant pis pour lui !), Insula Barbara, il ne pleuvait pas sur Lyon ce jour là, le toponyme signifie "île sauvage" une autre baie des anges, (ou des mésanges) pour le temps où les messieurs-dames à chapeaux couraient aux guinguettes le dimanche loin des encastrements de maisons. Prendre le vert, où bientôt à tête d'Or, côté rive gauche on ressortira les embarcations pour voguer entre les canards et les canetons, (parfois les cygnes) jusqu'à ce que le disque use sa plage et que la chanson n'en finisse plus de boucler sa ronde sur le sable invisible, de Lyon-plage en presqu'île, le grain du sable grondant en dedans de nous à jeter les pépites d'or de Don Rodrigue, tout en marchant le long des quais entourés d'une nuée d'oiseaux qui suivraient le grain des semeurs (ou semeuses) de pépites jusqu'au bout du monde. Nous y sommes, et je pense à Gauguin, quittant Paris pour Tahiti, avec un seul désir :
Composer au plus simple ne plus créer que de l'art simple.
Il y a des jours où tout paraît si évident, à Lyon Presqu'île ou dans les îles du Pacifique, entre les deux une navette ferait des allers retour Lyon-Papeete. Nous acheminant... (It is not bad. It's better than nothing) comme rien...
Nota (*) : "La terre est bleue comme une orange Jamais une erreur les mots ne mentent pas" ces vers programmatiques sont extraits du recueil "L'amour la poésie" de Paul Eluard (1895-1952), paru en 1929, Eluard tenait "le flot de la rivière comme un violon", nous tiendrons très modestement, les flots du fleuve comme une mandoline ce ne sera pas un défi que nous ferons à Eluard, mais peut-être à son camarade Dédé, puisque l'on sait que ce dernier n'appréciait pas la musique mais les flots ne s'opposeront pas, même si ce sur ce coup là je laisserai très volontiers la main à Eluard (et son violon magique)...
Photo : Lyon presqu'île, vue sur la Saône côté rive droite photographié du quai de la Pêcherie qui est aussi le quai des bouquiniste, le samedi et dimanche. © Frb 2011.
23:17 Publié dans Balades, Certains jours ..., De visu, Impromptus, Le vieux Monde, Mémoire collective, Pépites | Lien permanent
mardi, 01 février 2011
Île flottante
Etrange ! il glisse des pans du monde à ma gauche et aussi derrière moi (un peu en oblique). Au delà de l'aire de mon attention, inutilement braquée sur l'inouï passage, ils dérivent...
HENRI MICHAUX, extr. "Personnel" in "Face aux verrous", éditions Gallimard, 1992.

Quand la nuit tombe, je tourne en rond. Il se peut que ces choses qui me sont étrangères se soient mises à parler dans mon dos, des phrases entières, quelques bruits de vos mondes qui reviennent à mes sens, inaudibles. Cette intrusion est semblable au silence qui précède, semblable au silence qui suit. Cela en vient à m'accabler à mesure que l'intensité du son se précise, toute signification des mots se brouille, il n'en reste qu'une trame, un continuum assourdi dont l'austérité pourrait pétrifier la mémoire, à force. J'ignore au juste ce qui m'est arrivé, je reste ici mais il se peut que je sois en train de perdre les amarres qui m'attachaient encore à vous. Cela advient, c'est une menace que je ne peux vous décrire, ni partager, ni garder pour moi seul. Elle est un éclat de roche erratique égarée dans un corridor. L'élément liquide se transforme en cristaux opaques et rigides, on dirait ces dessins d'étoiles que l'on trouve dans vos livres qui expliquent l'univers aux enfants. Je m'imagine, quelquefois devenir la synthèse du ciel et de l'Océan, cela tiendrait en quelques lignes. Ce serait la fin d'un roman. Ou bien, j'habiterais à l'intérieur d'un coquillage collé à votre oreille. Je ne peux pas vous décrire cela précisément. Je suis un élément perdu, flottant parmi les algues, confondu au milieu d'un système aberrant, le théorème d'une mathématique disparue, un théorème qui ne s'appliquerait à rien, cela donnerait toujours un résultat presque juste, presque faux, avoisinant celui de zéro, peut-être égal à un. Autour se trouveraient des milliards de chiffres auxquels nul ne comprendrait rien.
Chaque rais de lumière, chaque grain de sable est un hémisphère que j'avale, tout cela m'incorpore au mouvement qui ne peut s'inscrire dans aucun programme. Je suis seul, à présent. J'ai beau l'écrire, à vous, ou à quelqu'un, je ne sais plus comment une telle chose peut se ressentir, si cela m'appartient si cela m'a été appris par quelques uns de vos amis dans ce besoin de compagnie qui comble les trous, les vides et les silences quitte à les remplacer par des trous des vides et des silences mais pleins de bruits. Dois-je ressasser ainsi que je suis seul comme s'il était admis pour vous que je sois conscient de ma déchéance ? Les journées sont de plus en plus trouées. Tout se clive. J'éprouve le mouvement d'un très lent détraquage. C'est le seul sentiment qui me vient. Je pourrais facilement vous le décrire s'il me restait un peu de volonté. Je suis seul et ils sont innombrables. Ils me suivent. Les nuages liraient ils par dessus mon épaule ? Lisent-ils aussi dans nos pensées ? Tout cela pèse un peu. Je crois voir sous leur forme la cachette de mes ennemis. M'auraient-ils suivi jusqu'ici ? Ils transportent dans le ciel toutes sortes d'animaux, ceux des cages, ceux des niches, d'autres plus effrayants se seraient ils enfuis du parc zoologique ? Les loups de vos forêts, les chacals, et plus bas, les troupeaux, nombreux, innoffensifs, des formes oblongues ou rondes et, avec elles, encore cachés, les bontés ou les sacrifices. Ils traversent le ciel, les troupeaux, avec une douceur qui pourrait encore attrister. Rien n'est doux en réalité, nulle forme n'adoucirait tout ce qui dedans gronde, ces choses muettes sans courage, auxquelles je souhaitais échapper, elles vous quittent, me retrouvent, longent les flots, s'y reflètent, filant une trame intrépide, les animaux de partout rassemblés en troupeaux, et ces troupeaux me narguent. Ils vous gardent. Je n'ai pas les capacités de modifier la direction de ces nuages. Longtemps j'ai pu croire qu'en soufflant dessus, mais non... Ils m'emballent avec des histoires de pluie et de beau temps où s'emmêlent les votres mais je crains cet aspect trop affable. Ces nuages si serrés auraient-ils empapilloté les cornes du diable, pour venir ici me les présenter ? C'est coton. Savez vous, qu'ils en sont peut-être capables ? Les nuages cachent peut être des milliers d'entre nous et les autres, tous un jour portés disparus, volatilisés dans les rues, dans les bars, dans des histoires qui finissent mal, les victimes d'accidents d'avion, les soldats inconnus, et tous ces morts sans sépulture... Heureusement ils sont rares. Le ciel bleu, uni, me trouble davantage. Cette monochromie épuise tout. Ce lieu m'aura si patiemment désincarné, que lorsque je reviendrai chez vous, vous me trouverez méconnaissable. Je serai devenu ou trop jeune ou trop vieux. J'inspirerai des conversations à voix basses, des regards embêtés. Je connais déjà l'arsenal, tous les apitoiements et votre âme empressée à tirer son épingle au jeu d'une bonne action qui dissimule des champs de ruines, et toutes sortes de déceptions, vous inviteront à vous réjouir de savoir les autres au moins aussi mal aimés, bien aussi seuls que vous. Mais tout ce que je vous écris là, me semble plus sûrement dicté par un autre qui aura pris possession de ma pensée. Vous savez bien qu'en temps normal, je n'aurais jamais pu vous écrire de telles choses. Je suis pris sous cette forme, sous une autre. Quand je me pince fort comme on le fait pour se savoir en vie, ce pincement, je ne le ressens pas. Je pince l'air et l'air me revient, chaud ou froid. Je regarde : il y a juste deux doigts collés l'un sur l'autre, c'est absurde. Il n'y aurait pas plus que cela. Quand pour m'en assurer, je me griffe jusqu'au sang, rien de ce geste encore qui vous paraîtra brusque, ne laissera la moindre trace sur ma peau, je ne saignerai pas, aucune trace de griffure. Tout désir d'en savoir un peu plus me coucherait sur le bord de la route, je longerai vos mondes, en refusant toute participation, mais ici de route, il n'y a pas, juste une plage à perte de vue que la mer prolonge et entoure, et prolonge, etc...
Ainsi sans savoir que j'existe, ni me me soucier de vos affaires, je devrais être gai simplement de me trouver ici sur la plus belle île de la terre, celle dont chacun rêve, dans le plus beau désert, dans la plus belle nuit éclairée par le soleil le plus étincellant, suivant un souffle chaud qui ronge et sème au fil de l'eau des diamants venus de l'envers, les danses molles des écailles d'argent des môles empiffrés de méduses, tout un scintillement qui n'existe pas à l'intérieur de vous ni en moi. Certes, ce scintillement aura peu à peu saturé l'horizon. Il détruit maintenant l'objet de ma contemplation. Ce serait comme si un musicien se mettait un jour à avoir peur de la musique, de sa beauté, de sa révélation. Cette peur me trahit à mesure que je me sens devenir autre. J'ai parfois honte de me plaindre à vous, ainsi sans raison. Souvenez vous, je voulais écrire un journal. Noter tout, le moindre évènement, en consigner chaque détail, puis au retour, vous enticher dans les salons, des récits de mes voyages. Ils vous auraient collé des fourmis dans les pieds, une chair de poule pour chacune de vos émotions, vous m'auriez trouvé magnifique au milieu de mes diapositives de poisson-lune, ma façon de raconter, vous l'auriez trouvée magnifique aussi. Et le coeur à l'ouvrage amplifié de bonnes résolutions, vous m'auriez imité, je crois. Il y aurait eu des coups de foudre la foudre et les métamorphoses après quoi, nous aurions tout tiré vers le haut.

Voilà, ce que j'aurais pu écrire sur mes carnets, dans mon journal si la chaleur n'était pas aussi écrasante. Je ne fais rien. Depuis que je suis arrivé, je ne fais rien de mes journées. J'ai dû marcher lontgemps, avant de trouver l'ombre, juste assez pour construire une cabane. Auparavant, il aura fallu que je me débarrasse de la plupart de mes bagages ils étaient lourds, je me voûtais. Mais c'est étrange, plus je m'allège plus mon corps devient lourd. Je me suis démis des objets les plus précieux et leur poids, colle à moi, plus encore qu'au temps où je les portais. Je n'en n'éprouve aucun regret. Je ne fais rien, rien ne m'arrive, rien qui puisse honorer le projet de ce livre pour lequel je m'étais déplacé jusqu'ici. Maintenant, je ne fais que ramasser des coquillages, tous identiques, en général des multivalves qui ont une espèce de coquille articulée sur leur dos, ils se ressemblent tous à quelques nuances près. J'aime la nacre, la blancheur profonde de la nacre un peu boursouflée, forée dans la coquille. Cela constitue mon unique passe-temps. Je ne sais pas si cela vous paraîtra intéressant à lire, mais c'est devenu mon but, il est futile et passionnant. Je ramasse des coquillages toute la journée. J'en ai pour l'instant trois mille cinq cent cinquante huit, tous de taille identique, de couleur identique, je les trie patiemment, trois mille cinq cent cinquante huit sans compter les reflets de nacre dont les nuances imperceptibles sont connues de moi seul. Maintenant que je m'applique à cela, comme le ferait n'importe quel artiste envoûté par des coquillages, je me sens presque indifférent à tout mais toujours un peu seul, j'ai gardé mon harmonica. Je ne l'ai pas encore sorti de son étui. Pourtant je reste un artiste vous le savez, vous à qui j'aimais tant parler de choses qui ne vous intéressaient pas. Dites le à nos amis, s'ils m'oublient. Dites leur que je vais bien, et dites leur surtout qu'ici je suis heureux que je revis.
Demain, j'irai ramasser d'autres coquillages, je m'impose depuis peu une discipline très stricte, je me lève très tôt le matin, il me faut trouver-cinq cent quarante huit coquillages par jour tous identiques (hormis la nacre, dont les reflets doivent être différents, mais pas trop). A part ça les jours n'en finissent pas. Heureusement, j'agis sur les choses, je suis devenu extrêmement méthodique. Je ne ramasse pas un coquillage sans avoir fait au préalable mille deux cent soixante dix sept pas dont je note le passage dans le sable par une croix à mesure que je marche. J'avance, ensuite j'ai comme la certitude que ces pas ne seront plus à refaire. Je m'arrête après mille deux cent soixante dix huit pas, je me repose, un peu, deux minutes, pas davantage. puis je repars et ainsi de suite jusqu'à la tombée de la nuit. Si je n'étais pas aussi organisé, je crois que je deviendrais complètement fou.
Photo 1 : Une île flottante au parc de la Tête d'Or, à moins que ce soit la tête d'Or, elle même ! (qui remonte ? (my God !) sachant qu'on ne l'a jamais retrouvée. Photographié près d'un simili point d'eau qui borde une simili plaine sauvage peuplée de vrais flamands roses de vrais toucans, de canards authentiques vivant en parfaite harmonie avec les réels zébus et autres charmants wapitis...
Photo 2 : Un lac en forme d'Océan pacifique (si on veut) ou indien (à la convenance de chacun) plus près de l'esprit des flots du père Phonse (de Lam') à Saint point (ô lac !), vue dans le plus beau parc romantique de toute la galaxie, toujours le même, le Parc de Tête D'Or, à Lyon. Photographié au mois de Janvier de cette année là. © Frb 2011.
22:44 Publié dans Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, Correspondances, De la musique avant toute chose, Impromptus, Mémoire collective | Lien permanent
vendredi, 28 janvier 2011
N'importations
La banalité est faite d'un mystère qui n'a pas jugé utile de se dénoncer.
MAURICE BLANCHOT in "Faux pas", éditions Gallimard 1943.

Photo : D'un "Faux pas" de Blanchot aux vrais pas en Presqu'île, il n'y a qu'un fil (étroit émoi) vu à Lyon, à la fin de l'hiver de l'année dernière. © Frb 2010.
00:52 Publié dans Balades, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Le monde en marche, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent
mercredi, 26 janvier 2011
Piquants
La vieille fée se pencha vers le berceau et dit :
"Tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu en mourras !"
Et elle disparut aussitôt.
La dernière des fées sortit alors de sa cachette :
"Tu te piqueras le doigt avec l'aiguille d'un fuseau, mais au lieu de
mourir, tu t'endormiras. Ton sommeil durera cent ans. Et à la
cent unième année, le fils d'un roi viendra te réveiller."...
CHARLES PERRAULT in "La belle au bois dormant"
Vous pouvez cliquer sur l'image, mais vraiment, vous n'êtes pas obligés...
Le temps à l'état pur disperse les cendres du hérisson. J'ai erré dans la ville, au coeur des quartiers riches jusqu'au parc de la Tête d'Or, j'ai adoré m'obnubiler derrière une vitre du déjeûner des animaux, du porc-épic, surtout, ce rongeur gros comme un petit ours, de nature myope et solitaire qui limite sa vie sociale aux capacités de la reproduction. Ce monstre errait ici dans la même ville que moi, à quelques mètres de ma maison, et c'était bien la première fois, que j'en supposais l'existence, la volumineuse toison, (environ 30 000 poils piquants sur le dos et la queue) son effrayante gueule sans affection, ne m'inspira que des questions, celles ci à ce jour me hantent encore. Ce monstre m'aidait pourtant à devenir plus étrangère à mon espace, étrange aux univers crées en voie de transformation. Il n'y avait pas de piquants sur les "trois grâces" de dos, (je vous les montrerai un jour), mais près des serres majestueuses, d'énormes cactus ou plantes succulentes, des euphorbes cactiformes au suc laiteux comme l'euphorbe réveille-matin et des hommes poussant des landaus, l'air si las des pères de famille qui rêvaient à perdre la boule devant l'épurge (ou herbe à la taupe), jusque là, le monde était assez lisse... Un groupe de vieux messieurs riait autour d'un aquarium où nageait tranquillement leDiodon holocanthus, une espèce de poisson ayant la capacité de gonfler pour effrayer son agresseur jusqu'à prendre une forme sphérique mais aussi qui posséde des piquants, ce qui le distingue comme chacun sait du Tetraodontidaé, qui lui n'en n'a jamais porté. Et puis, j'imaginais les femmes sillonnant en Janvier la ville dans des manteaux cousus de piquants, cueillant à pleines mains des bouquets de chardons ou Carduus (chardons proprement dits) aux bras des éminents, on croiserait l'érudite avec une étole parsemée de Chardons Roland (Drachons Drolan, drapon). Ce nom vient de "Chardon roulant", car en hiver, les pieds morts de l'ombellifère bien ramifiés vaguement anordis sont facilement emportés par le vent, ce qui aide à la dispersion des graines, (merci ouiki), ne pas confondre avec les belles fleurs pourpres à réceptacle charnu appelées "Chardon Hozan", Chardon aux ânes, dont la bordure épineuse (appelée parfois "Baiser barbu") se prolonge à la base le long de la tige. On pourrait vous faire un dessin, mais on va faire mieux, on va vous montrer une photo de la capitule de la plante. Ainsi je traversais les mondes tout piqués de partout. Baisers d'oursins, butinements d'hyménoptères, feuilles du pissenlit, hantise des futurs nuits d'été et son moustique piqueur, suceur, becs d'oiseaux, aiguilles des conifères puis je piquais du nez en terrasse au Rive gauche, bistro de Vitton près d'une citronnade amère flottant sur des glaçons, je goûtais tout l'âcre de l'agrume qui me piquait les lèvres. A la table à côté, La piquante Michèle P. me présenta Pennequin (Charles), l'écrivain et non Maurice (Pennequin), l'acupuncteur inconnu, au cheveux raides (comme des picots), Charles, un auteur pas piqué des vers, tandis que (dernier coup de balai des soldes oblige !), un Valet de coeur me révélait son As de pique, délaissant l'amie picassée dans le lisier de ses acides (ça pique assez, pour le bon mot) ô vexation force, tyrannie. Piquée au vif, je me consolais dans les bras de Patrick, (marmiton rue Lepic, rendez-vous à Picpus), il avait un corps olympique, et une barbe de trois jours, il me murmura à l'oreille "ça pique ?" "Oui, mais j'aime bien", puis nous partîmes escalader le pic St loup bras dessus bras dessous (inutile d'ajouter que l'expédition fût épique). En parlant de foutraque As de pique, faut savoir qu'au XVII em siècle l'expression très péjorative désignait (chez Molière entre autres) un personnage stupide ou mal bâti, au XIX em siècle, la ressemblance très approximative du pique à un croupion de poulet, fît naître en argot l'as de pique" pour signifier l'anus. Quelqu'un qui se faisait traiter ainsi était grosso modo un trou du cul. Dans mon histoire (Il n'y a pas que Molière), le Roi de coeur remplaça le Roi de pique, qui est aussi la plus forte carte de l'enseigne des piques, les joueurs de cartes n'ignorent pas que l'enseigne désigne originellement non la couleur mais la marque des reconnaissances des quatres séries elle représente pour le Roi de pique la pointe d'une hallebarde ou de la lance, au Moyen Âge cela renvoyait aux groupe sociaux, le pique représentant l'épée ou le métier des armes, le Roi de Pique s'appelle David et le Roi de coeur s'appelle Charles, l'un se rase l'autre pas. Mais pour moi c'est celui qui pique qui tirera toujours mieux son épingle du jeu que celui qui pique pas. Et... (admirez l'enchaînement) avant de retourner à mes travaux d'aiguilles, (fille oblige) pour terminer je poserai à ces dames lectrice de Certains jours une question qui ne me laisse aucun répit :
Existe-t-il une opposition diachronique entre l'aiguille qui a cousu le chaperon et l'épingle qui permettra de le fixer ?
J'ai bien reçu une réponse du petit chaperon rouge qui nous a écrit du Forez, c'est ce qu'elle dit au loup :
"J'aime mieux le chemin des épingles avec lesquelles on peut s'attifer que le chemin des aiguilles avec lesquelles il faut travailler".
Ainsi, nous lirons le contraste entre les deux versants de la vie féminine, le "côté des aiguilles" et "le côté des épingles", comme le dit proustiennement une version ardéchoise de cet univers, lieu d'apprentissage et de transmission d'un savoir spécifique où l'homme demeurera exclu :
Needles and pins, needles and pins,
when a man marries his trouble begins. (1)
Sur ce, une très vieille fée m'apparait, tandis que j'ai mis mon doigt bien distraitement sur un fuseau, et maintenant j'ai les yeux qui piquent, le fait est que j'ai drôlement sommeil, (pas vous ? :)
Dans cent un ans, je vous raconterai la vie affective de Nestor, mon hérisson préféré, à condition qu'un monsieur, pas moins que prince et pas trop vilain (s'il vous plaît, faites un effort, messieurs!) ni trop pauvre (les princes en Twingo, j'en ai marre), ni trop glabre, daigne me réveiller par un baiser, (le plus doux, je l'épouse, merci d'avance, dans cent un an j'y serai, même endroit même heure.) Je cède ce blog à ma remplaçante, double et mauvaise rep(l)ique, sans coeur, sans âme, méduse, ortie, rose, aragonite, stibine même un peu quartz, pis que clone donc, qui paraitra grâce à la seringue et la micropipette, née d'une rencontre improbable avec un porc épic et quelques pages des Tropiques du capricorne ou du Cancer :
"Je ne peux me sortir de l'esprit l'incohérence qu'il y a entre les idées et la vie. Une dislocation permanente, même si nous essayons de les dissimuler sous une bâche. Et cela ne s'en ira pas"
Même sous une toison d'environ 30 000 poils ça ne s'en va pas, la dislocation. Alors hein, bon. Zut.
Source (1) : Extrait de Les deux chemins du Petit Chaperon rouge. Frontières du conte. CNRS, 1982.
Photo : The beast. Porc-épic véritable, la photo est ratée, sorry, mais c'est normal, la bête est très difficile à saisir surtout à l'heure de sa gamelle (remarquez, il y a des gens comme ça aussi, on ne va pas critiquer les animaux, ça serait le pompon !), photographiée un jour de Janvier au Parc de la Tête D'Or à Lyon avec une sorte de furet dont j'ai oublié le prénom. © Frb 2011.
02:57 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Mémoire collective | Lien permanent
lundi, 17 janvier 2011
La grande route
Parfois le murmure se répand que nous sommes visités par des ombres transparentes.
Qui sait ? Qui sait ?
Comment retrouver leurs traces quand on a peine à se retrouver soi-même ?
HENRI MICHAUX, extr. "L'Espace aux ombres" in "Face aux verrous", éditions Gallimard, 1992.
pour connaître le début de cette histoire vous pouvez cliquer sur l'image
Les jours passèrent longs et stupides, nous étions moins joyeux. Nous avions laissé les chansons, fabriqué des chapelets. Ils ne servaient qu'à passer le temps. Nous nous bercions de prières, nous les récitions à voix haute en marchant. Elles portaient aussi d'autres chants, nous avions cessé, à force de répétition, d'en ressentir tous les bienfaits. Au mieux, cela nous fatiguait. Une lueur blanche émanait d'un sommet. C'était là, notre terre promise. Il semblait que là haut, les châteaux se multipliaient. Nous fûmes un instant en Espagne ou mieux, en Amérique. Les habitants semblaient agglomérés en un point lumineux qui se trouvait sur la lune mais ce n'étaient que les formes exagérées de la lune qui chaque nuit hantaient nos rêves de présences et de sons. Nous entendions les voix des créatures nous parler dans l'oreille ; ce langage, nous l'avions connu peut-être autrefois, il nous rappelait encore une langue disparue, celle des villes où nous avions vécu. Nous nous étions persuadés que ces voix étaient incarnées quelquepart en un lieu qu'il fallait découvrir avant que nos forces s'amenuisent. Un jour, on l'espérait, elles viendraient nous guider, elles pourraient même nous accueillir. Quelquepart il y aurait un point où nous pourrions cesser de marcher, enfin, vivre tranquilles ! nous avions fabriqué ces voix à force de croire que nos vies pouvaient être éclairantes pour d'autres vivant à l'opposé, sur d'autres rives. Nous avions tant de choses à nous apporter, entre étrangers, comme s'il était promis à ce faux semblant de hasard, l'avènement d'une forme charitable, attirée par la nouveauté qui pouvait entièrement combler un besoin de réenchantement mutuel, infini. Nous avions fabriqué ensemble, une légende à venir, envoûtés par une sorte de fièvre. Nous voulions des héros pour conjurer l'ennui. Croire en de nouveaux dieux, peut-être. Nous avions traqué jour et nuit, les manifestations des créatures. Nous cherchions dans le moindre craquement, les bruissements d'insectes, un contact serré avec les créatures, même une simple brindille nous faisait sursauter, il s'ensuivait un grand émoi, tout dans la démesure. Nous avions même appris à lire, peu à peu les variations émises par le vent, à tel point que nous aurions pu en écrire les rythmes sur une partition, cela aurait pu être joué dans nos anciennes villes par les plus grands orchestres symphoniques. Nous en rêvions. Nous étions restés à l'affût, jusqu'à cette obsession d'établir un dialogue avec les créatures. Il était impossible qu'une seule d'entre elles ne puisse pas nous comprendre et peupler rapidement le vide dans lequel nous vivions. C'était une intuition commune, une rêverie fraternelle, par laquelle, nous nous proposions de bouleverser nos existences. Les voix nous revenaient en songes, elles s'étaient indistinctement mêlées aux notres, plus ordinaires, ou presque aphones, nous avions hâte d'ajouter un choeur à nos chants, pour réanimer tous les souffles. Les voix en réalité demeuraient inaudibles, plus muettes que l'espace qui vibrait des sons pleins de ce vide intenable, et d'une solitude collective plus harcelante encore que si nous avions été seuls en réalité. Le jour où nous en fûmes conscients, notre vertige se transforma, en une sorte d'effroi, une chute qui porta le malheur et la confusion entre nous. Maintenant, quand la lune est visible, c'est pire. Dans ces nuits là, l'effroi revient à l'identique, et il n'en finit pas, jusqu'à la disparition de la lune au petit jour. Le ciel est vide. Cela nous fait apprécier les moments où nous ne sommes plus inquiets les uns des autres. Marcher devient notre principal soulagement, s'il n'y avait pas ce vide, par instant, il nous serait sans doute plaisant de contempler le paysage, tout en marchant même si jamais nous ne trouvons le lieu. Il faudrait oublier. Quitte à créer n'importe quoi, comme toutes ces statuettes en bois, des marionnettes, ou reculer, retrouver l'ignorance des débuts, quand chacun croyait que le pays que nous cherchions était tout près. Il suffisait de bien s'entendre, surtout d'être patients, d'imaginer que la grande route qui s'allongeait déjà, à mesure que nous la déroulions, n'était qu'un pont reliant une rive à une autre. Les créatures lunaires, profondes, au lieu de nous secourir, nous avaient éloignés les uns des autres. Aujourd'hui il y a non seulement la route, mais une autre route entre nous, invisible qui nous happe et nous coupe en morceaux. Aussitôt que parait la lune, notre ancienne hallucination nous clive, nous restons des heures allongés dans l'herbe, les yeux ouverts, sans trouver le moindre charme aux étoiles. Nous reprisons de vieilles pensées, en accusant secrètement ceux qui étaient autrefois les notres, comme nous, ensorcellés dans l'ombre roulés par une lueur, nous les haïssons de nous avoir aidés à croire à des choses impossibles. Le reste du temps, nous sommes presque muets, figés par ce qu'il nous vient de haine, elle pousse en nous, nous sommes tous dans le même état, impuissants à la repousser. Nous ne partageons plus que des banalités. Un jour nous deviendrons complètement sourds. Il ne restera que cela, la hantise dévorera nos figures, la laideur entre nous perceptible, jour après jour, creusera nos traits, assèchera ce peu d'enfance qui nous choyait avec ses créatures splendides. Ces lueurs répudiées diffuseront l'incendie, sous la chair et nos corps gentiment en apprivoiseront les débris. Nos yeux s'abîmeront à force de ne cotoyer que cela, toute la sécheresse et nos figures devenues suspicieuses n'auront plus la moindre expression amicale. Il n'y aura plus d'emportement facile, à mener nos chevaux de bois au festin de la lune. Tout ce manque nous abolira, quand la panique devenue coutumière, nous donnera enfin l'impression de solidité, nous continuerons sur la grande route, nous marcherons en file indienne, tout comme avant. Pas tout à fait. Nous marcherons, c'est tout. Nous dormirons dans les forêts. Rien ne sera changé. Apparemment.
Photo: La grande route (des Charpennes) dans tous ses états, photographiée de la fusée d'occasion Appolo 11 aimablement prêtée (et pilotée) par trois vieux copains cosmonautes (merci les gars !), afin de nourrir les fantaisies démesurées de certains jours. Villeurbanne. © Frb 2010.
14:11 Publié dans Art contemporain sauvage, Balades, Impromptus, Le vieux Monde, Mémoire collective | Lien permanent
samedi, 15 janvier 2011
Persévérance
Il faut imaginer Sysiphe heureux
Photos : Le pied du mur insiste et signe, heureusement les injonctions sont roses. Elles ont été photographiées dans une rue des pentes à Lyon (j'ai oublié son nom) menant au sommet de la colline qui travaille évidemment (un peu de la coiffe et du pinceau). Il manque peut être la girafe (?) elle n'est pas loin, (au parc de la tête d'Or exactement, avec les Watusis), on la sortira peut-être au printemps, si il fait beau. © Frb 2010.
09:41 Publié dans Art contemporain sauvage, Arts visuels, Balades, De visu, Impromptus, Le nouveau Monde, Mémoire collective, ô les murs ! | Lien permanent
mercredi, 12 janvier 2011
Vues de nuit
Pour qui s'enfonce sans peur dans ces labytinthes ténébreux, la nuit est pleine de retraites inconnues, de territoires vierges. Au gré de l'imagination des créatures qui l'habitent se révèlent soudain avec sur leurs corps, les traces mystérieuses de leurs pérégrinations. Il n'appartient pas à tout le monde de s'enfoncer d'un pas ferme dans ces solitudes...
ROBERT DESNOS, extr "Les trois solitaires", (longtemps après hier etc...), éditions les 13 épis, 1947.
Pour voir une autre nuit, il suffit de cliquer dans la nuit
Je les vois, près des zincs se mêler aux danseurs, ceux qui trinquent à minuit font trêve et davantage, se réjouissent dans le bruit, aspirent à l'essentiel laissent le soin à d'autres d'arroser leur chemin. Dans la crainte d'abord, d'être absorbés par les battements d'une horloge qui rétrécit leur monde, ils l'emballent avec eux au guet des ombres, jusqu'à ce que son mouvement s'arrête. Aussi compréhensifs que les amants, ils franchissent les portes, trainent sur eux les traboules puis ils flanent, unis en grappes sûres mais toujours seuls.
Je les vois sur les quais, le long des fleuves adorer les scintillements, et criant dans le souffle asséché de l'hiver des injures à nul autre qu'eux mêmes. Cette liquidation dont librement ils s'acquittent, semble filtrer encore le mauvais sang des jours qui ont précédé. Ils se scellent au ciment, contemplent les péniches, les terrasses des restaurants, dans l'éclat du rissolement des poulardes ou les odeurs de poissons frits. Ils réecrivent chaque nuit, la même histoire, tradition urbaine et orale, la préface d'un conte braille ou l'écho d'un chant né dans la hâte d'en finir puis d'éparpiller toute l'intensité inhérente à la joie de s'anéantir. Je les vois, seuls, trinquer avec tous leurs amis d'une heure, ils ne doutent pas qu'ils peuvent se lier éternellement, veiller à ne jamais laisser d'autres les perdre dans la plus abondante réserve de mots, de promesses. Ce tintamarre... Je les retrouve plus loin, plus gais, ils fanfaronnent plus saouls aussi, à d'autres zincs mais émus de la même façon à la vue d'une horloge qui vient de s'arrêter. Je les vois dans ma rue, titubant endormis près d'une villa bordée de bergenias sans fleurs, pendant que leurs amis, les quittent déjà, s'en vont mener un autre slow sur "Valentine" près des fausses cariatides du bar d'un hôtel chic.
Toutes ces processions en marche sur la terre, nous observent impassibles, rient en coin de nos rythmes. On pourrait soupçonner que l'arrêt d'une horloge irait enamourer tout le reste du monde. La nuit vante l'avantage de se brûler à ces amours qui n'espèrent pas, n'offrent rien en retour. Un sang commun circule dans leurs veines, ils embrassent comme rien des filles qui leur déplaisent. Elles attendent sur des strapontins. Elles sont même là pour ça. Le deal est simple, ça reste honnête. Eux, ils restent au fond de l'aquarium avec leurs yeux ronds leurs barbillons de poissons-chats, longeant les serres ou traversés d'icebergs, de mondes flottants sucrés, givrés, peu importe là, partout, ils ont le pied marin, la colère des grands capitaines, et de belles euphories pour claquer les chagrins. Cette liquidation, toujours la même les tient en équilibre entre deux fleuves, le coeur tâtant du vide au sommet des falaises, les pare d'arc et de flêches, d'un nom de plume vaguement mexicaine.
Je vois nos emplacements se déplacer comme eux, courir derrière l'ivresse, rejoindre les collines à la recherche de plantes vénéneuses, comme l'herbe de bisons, dans sa grande bouteille verte, ils entament avec elle, la tristesse d'un coup de barre, puis vers quatre heures, ils ressucitent.
Je les vois transformer les fleuves en bord de mer, admirer rue de l'Alma au loin les caravelles, je les retrouve à cinq heures, affalés sur des bancs, et toujours le ciment, pour eux méconnaissable se transforme en lit de camp ou en échasses obliques pas plus hautes qu'une allumette à craquer dans la nuit, pour tout ce qui embrase, et qu'un feu brassant l'air, provoque l'incendie sur la ville. Un lever de soleil, les ramène avec le premier bus bondé de gens, dans un champ de savons, là où ils ne savent plus, à cause de la lumière, exactement par quel chemin retrouver leur maison.
Photo : Berges du Rhône by night vu d'un vélo garé sur un pont entre rive gauche et Presqu'île à Lyon, photographié au mois de Janvier, un certain jour. © Frb 2011
01:40 Publié dans Arts visuels, Balades, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Le nouveau Monde, Mémoire collective | Lien permanent
jeudi, 06 janvier 2011
Comme des fourmis qui n'ont rien à faire...
Pour tout être humain, quelles que soient sa force et sa résistance, il existe ici-bas une chose unique à lui seul destinée, qui est plus forte que lui et toujours le domine, qu’il est incapable de supporter !
WITOLD GOMBROWICZ extr. "Le rat" (écrit en 1939) publié en 1933, dans la revue littéraire de Varsovie "Skamander". Publié dans le recueil de contes "Bakakaï" (1957), disponible aux éditions Gallimard (Folio) 1990.

Notre cercle est bancal. Nous obtenons un grand nombre de directions et nous sommes arrivés presque à destination dans ce hors-lieu entravé de calcul mental. Des divisions, des soustractions. A pinailler sur des virgules. Nous nous privons c'est ça, notre habitude. Quand nous croyons renaître, il se trouvera toujours une phrase pour gâcher tout. Notre réponse vient par réflexe mais sans ferveur. Les dits s'agrémentent de modifications mais ça dépend encore de nous : "les prix augmentent chaque jour". Ou bien : "le but c'est de joindre les deux bouts.", ou encore, "Oui, mais l'essence coûte cher, la carte grise et la vignette sans compter l'assurance... quand même !". Pour changer la conversation, desfois j'évoque des sujets différents, comme "la cuisine à l'huile de noisette" ou "le retour des pantalons à franges", histoire de détendre l'atmosphère. Au lieu d'en rire, vous pleurnichez, vous sortez vos "quand même", vous dites "C'est quand même malheureux ! avec les femmes on ne peut jamais avoir une vraie conversation intelligente", vous dites : "Les gens ne savent pas combien ils sont superficiels, ils faudrait qu'on leur dise un jour, quand même !". Pour vous, tout est superficiel. Votre lucidité monte au ciel jette sur nous le tonnerre, qui nous éclaire de "vérités", votre lucidité engloutit l'univers pour faire advenir en nous la conscience, ces menaces qui grouillent alentour et nous poussent aux regrets. Vous en voulez au monde entier comme si le monde entier se devait de souffrir à votre place. Avec vos airs tout pétris de "quand même !" qui voudraient nous apprendre à vivre. Sans chercher à savoir quelles vies nous avons traversées. Vous dites : "ce n'est pas le moment de plaisanter, nous parlons de coût de la vie, faudrait pas tout confondre, quand même !". Et vous comptez encore combien nous serons chez vous à table. Toutes ces bouches à nourrir pour une simple soirée. Dieu sait combien cela va encore vous coûter !
Notre vie est progressivement réglée par vos "quand même" qui s'offusquent à propos de tout. Nos facéties, nos jeux, vous paraissent encore trop légers au regard de ce que vous appelez "les choses essentielles", le prix de vos efforts. Votre sens du principe de réalité qui foule aux pieds nos rêves avec l'insolence d'un banquier qui considérerait ses semblables comme des produits dérivés de sa succursale, rassemblés en petits paquets sous le terme générique de "partenaires". Vous parlez d'argent sans arrêt. Vous déplorez, l'ingratitude, l'indifférence des "gens" cette entité sournoise à laquelle il vous déplairait au plus haut point d'appartenir.
Quelquefois, je me balade avec d'autres dans mon genre au milieu de villes-champignons, on est de plus en plus nombreux, à avoir des toupies dans la tête, on erre, on se perd, on tourne comme des fourmis qui n'ont rien à faire. On contemple les nids déserts, ça procure un léger malaise que le vent d'hiver atténue. Si une ou deux fourmis osent exprimer la volonté de se remettre au travail, on les tue. La bombe anti-fourmis diffuse une senteur de violette, d'après un procédé que j'ai mis au point avec des corolles de violettes et quelques savants paresseux. Tout le monde croit que les fourmis se désintègrent, c'est faux. En réalité elles meurent petit à petit d'intoxication. C'est ni vu ni connu.
Après on rentre chez soi dans ce décor hybridé de mandalas et de nappes provençales. On reçoit des amis qui viennent chaque mercredi jouer aux dominos à la maison, et c'est à peu près tout. Parfois nous revient le goût des belles conversations. Nous répétons généralement des choses que nous pêchons dans les internettes, nous n'avons pas grande difficulté à faire croire qu'elles sont de nous. Ce qui est à nous on le précipite dans la clairette de Die Monge-Granon, les crémants dorés de la veuve Ambal. On ne fait même plus la différence entre la Clairette et le Champagne. On en est même venus à se persuader qu'entre les deux il n'y a pas de différence du tout, à part le prix. Le guacamole, on le fait soi même et vous nous offrez les sushis, on dirait pas à voir, vous dites que les sushis "quand même ! c'est très cher pour ce que c'est", vous dites que "les traiteurs se font pas mal de pognon," ça nous fait partir au Japon, ceux qui ont vu les films d'Ozu, en parlent, ceux qui ne les ont pas vus, se sentent un peu idiots. C'est toujours l'idiotie qui gagne, pas de quoi en faire un drame.
A force de faire briller toutes nos vies tous nos sous, nous sommes devenus teigneux par ce péché d'envie, de jalousie, et ces compétitions que nous apprenions dès l'école dans les classes ou pendant la récréation. Nous voudrions engranger plus de choses encore et nous manquons d'espace. Nous défendons le cercle, un lieu irrespirable. La cause est entendue, le dépassement de la vie les limites et nous même, on est dans la boîte à photos caché tout au fond d'un placard. Le passé nous prendrait dans ses flammes si nous nous souvenions un peu, de cette grande espèce de tendresse qui nous mettait du vague à l'âme, mais au prix d'une si grande faiblesse... On en parlera plus. On promet "plus jamais". Ca devient tellement sinistre toutes ces choses dont on parle sur tous ces convertibles montés en kit, qui viennent tous de la même boutique. Ces additions, ces multiplications. Comme si cette obsession de vouloir changer tout, trainait aujourd'hui un poids mort, la dépouille des grands fauves, ces doux parfums d'hier dont on ne peut plus se détacher, ce feu qui brûle sans nous dans les caves et dans les greniers.
On s'y laissera tenter. Peut être un jour, l'idée de jeter au loin ce vieux don de taxidermiste nous trouvera métamorphosés, mais ce serait une chose trop vaste, sûrement insupportable. Il faut bien constater que nous sommes devenus étriqués. Cette idée de tout dépasser pouvait déplacer les montagnes, nous en étions persuadés, on traversait la chaîne des évènements vécus ou crées sans apercevoir les obstacles. On décuplait les songes et tout devenait vrai. Une géante rouge tombait du ciel nous offrait les constellations qui amplifiaient nos chances : lueurs, parfums, messages... Nous ne pouvons pas admettre, que l'écho s'en retrouve aujourd'hui enfermé dans les cavités les plus sombres de notre mémoire telle une pâte refroidie, un trésor qu'on dilapidait sans savoir, à force de l'ignorer, qu'il faudrait finalement, un jour ou l'autre, se mettre au travail jusqu'à cotoyer l'idiotie qui gagne tout.
On repense à cela par hasard et la chose pèse plus ou moins lourd. On radoterait à la répandre. Toute cette nostalgie est déjà si prégnante qu'elle finira par nous faire honte. Il se peut qu'on en sorte de plus en plus bavards, ces milliers de conversations nous mettrons la tête dans le sable. Nous serons de plus en plus sourds. Desfois quand vous semblez navré de si mal nous comprendre, vous évoquez votre sentiment de solitudes, vous dites "mes solitudes", telles des propriétés, chacune a sa nuance que nous ne pourrions pas discerner... Et quand, enfin vous vous interessez à nous, c'est comme si vous lanciez des cailloux dans une mare, moi, j'aime bien "la mare à cailloux", dont parle souvent Marcelle Sand à moins que ce soit encore La Pinturault qui ait lu ça dans "Miroir du monde". Ca ricoche. Tout devient du pareil au même. Et puis il reste les questions que je vous pose, quand nous nous retrouvons tous les deux à faire comme si on était plus nombreux, jamais nous ne tombons d'accord pour savoir qui, de cette somme incalculable de personnes, est la plus réelle d'entre nous.
Nota : Le titre de ce billet est inspiré par une phrase tirée du livre de John Cage "Silence" paru chez Denoël en 1970 puis 2004, dans la collection "Lettres nouvelles" (traduit par Monique Fong), un ouvrage vivement recommandé par la maison.
Photo : La marche des fourmis qui n'ont rien à faire, tag au pochoir saisi à l'arrache sur un mur la place Colbert, inspiré par Marcel Darwin et ses héritiers spirituels. Photographié à Lyon, au mois de December. © Frb 2010.
lundi, 03 janvier 2011
Sur le banc du Marquis
Si l'imaginaire risque un jour de devenir réel, c'est qu'il a lui-même ses limites assez strictes et qu'il prévoit facilement le pire parce que celui-ci est toujours le plus simple qui se répète toujours.
MAURICE BLANCHOT : extr. "Après coup", éditions de Minuit, 1983.
Pour le lecteur qui désirerait lire sur un banc plus frais, il suffira de cliquer sur l'image
Sur le banc du Marquis, je me suis réveillée ce matin et je me suis aperçue que tous les chiffres de l'année avaient été changés sans que je n'en sache rien. La neige avait fondu mais le banc demeurait alcestien, plus que jamais, tout entier, situé en un point précis quelquepart entre "La Quiétude" et les monts du Lyonnais. Sur le banc du Marquis, je me disais qu'il serait bon de ne plus penser à rien, comme il est de coutume sur les bancs. Le froid invitant à plus de lascivité à la mesure du temps et de la neige qui fond jour après jour mais au fil de ce souhait, me venaient à l'esprit des tas de trucs et des tas de machins que je ne pouvais empêcher, malgré ma volonté d'atteindre cet état inséparable de l'être qu'on appelle le vide.
Sur le banc du Marquis, j'ai pensé aux feuilles plissées de l'héllébore, à ce petit jardin d'iris jouxtant, dans la banlieue de Lyon, un immense incinérateur à ordures. J'ai pensé à la loutre marine qui posséde l'une des fourrures les plus précieuses au monde et qui a une manière amusante de faire la planche en écrasant des coques de palourdes contre un galet pressé sur sa poitrine tout en portant à sa gueule le meilleur de ces fruits de mer. J'ai pensé que la loutre marine ferait un excellent casse noix ou un gros casse-noisette qui pourrait épater les copains. Sur le banc du marquis j'ai pensé aux jeux décourageants, de patience, de Max Jacob dans "Le cornet à dés", et puis aux disques de Pierre Henry qui remplissent l'air de rock n'roll.
J'ai pensé à tous les imbéciles qui composent des musiques rien qu'en tapant sur des casseroles, à Napoléon qui ne se trompe jamais, aux mystères non révélés de la boule de gomme. J'ai pensé aux atomes qui s'entrechoquent et au "Miracle du Saint accroupi" dans "Les minutes de sable mémorial". Sur le banc du Marquis j'ai pensé aux triomphes de la psychanalyse, à cet arbre penché qui penche depuis longtemps à cause du vent, j'ai pensé que je ne savais pas si fallait couper l'arbre ou supprimer le vent. Sur le banc du Marquis, j'ai pensé à ces politesses extrêmes qui cachent les plus grandes agressivités, j'ai pensé à l'irrationnel, aux héros qui ne meurent jamais, sur le banc du Marquis j'ai pensé que je pourrais être marquise ou duchesse réincarnée grâce aux voyages dans le passé, (en servante à la harpe en Egypte par exemple). J'ai pensé aux soucoupes volantes qui perdraient leur attrait si on apprenait qu'elles ont été fabriquées par des ingénieurs de l'aéronautique terrienne, j'ai pensé à ces gens qui n'existent qu'en fonction de l'autorisation de ceux qui se proclament leurs supérieurs, à ces autres gens qui se lamentent à propos de petits problèmes et ne s'en prennent jamais à eux mêmes. J'ai pensé au cauteleux, au figé, aux lézardes et à l'opulence, aux tumulus sableux et aux tombes trapézoïdales. Sur le banc du marquis j'ai pensé à ces "pointilleux" qui ont peur d'abîmer leur voiture. J'ai pensé aux voyages en ville en tramway, aux cacahuètes bouillies, aux sonates et aux interludes. Sur le banc du Marquis, j'ai pensé au Marquis qui posséde les clés d'un langage oublié, à la pierre de Rosette et aux mérites de Ptolémée. Sur le banc du Marquis j'ai pensé, à l'exaltation de la volonté jusqu'à sa désintégration finale, menant à l'imagination la plus anachronique et la plus débridée, j'ai pensé à la noblesse du banc malgré l'absence de particule. Aux redondances du menuet qui navigue entre les billets. Sur le banc du Marquis, j'ai pensé encore aux sonates et aux interludes...
JOHN CAGE/ JOHN TENNEY : Sonatas and Interludes
Sur le banc du marquis j'ai soudain cessé de penser, j'ai dû rêver que les chiffres étaient devenus équivalents, peut-être insignifiants et que par conséquent le monde aurait peut-être une forme très différente si personne ne savait compter. J'ai pensé que l'année prochaine aurait lieu avant cette année mais en l'ignorant bien, nul d'entre nous ne devrait pour l'heure s'en soucier. Sur le banc du Marquis j'ai pensé...
Photo : Le banc du Marquis, situé entre la quiétude et les monts du Lyonnais près des dunes et de la forêt (enchantée) jouxtant le château de Montrouan, quelquepart en recoin d'un jardin d'hiver, bien caché au fond au Nabirosina. Photographié aux derniers jours de December.© Frb 2010.
18:59 Publié dans Art contemporain sauvage, De la musique avant toute chose, De visu, Impromptus, Mémoire collective | Lien permanent